Le 3ème Régiment d’automitrailleuses (3ème RAM) où est affecté le lieutenant-médecin Soubiran est composé de 5 escadrons, l’un d’automitrailleuses rapides Panhard, un autre de chars légers Hotchkiss 35 (équipage de deux hommes, pas de radio), un de canons antichars et les deux autres de motos. Il fait partie de la 3ème D.L.C. (Division Légère de Cavalerie) du général Petiet ; il a passé la drôle de guerre en Lorraine, secteur de la 3ème Armée (Q.G. à Metz) ; et a pris position à proximité de la frontière luxembourgeoise, prêt à contre-attaquer les troupes allemandes qui pénétreraient au Grand-Duché.
C’est précisément ce qui se produit le 10 mai 1940. On s’y attendait bien un peu. À 6 heures du matin, l’escadron de Soubiran est sur pied de guerre, devant l’église d’Audun-le-Tiche (Moselle), un peu à l’est de Longwy. Les conducteurs des automitrailleuses « me déconcertent. Ils rient. Ils parlent bruyamment […]. Sont-ils « gonflés » ou inconscients ? ». À ce moment surgit un avion allemand qui frôle la cime des arbres. Vrombissement et claquement des mitrailleuses. Soubiran plonge sous un massif de buis, se relève couvert de terre. Un side-car lui amène le premier blessé, les cheveux collés sous le sang coagulé. Mais ce n’est pas trop grave, « la balle est sous la peau, amortie par le casque ». Ceux qui plaisantaient encore il y a quelques minutes sont stupéfiés, conscients tout d’un coup du danger. Ce camarade a été blessé juste à la frontière : les Allemands ont donc déjà traversé tout le territoire luxembourgeois !
Combats de pointe au Luxembourg
Soubiran procède avec un véhicule sanitaire aux premières évacuations, dont celle d’un fantassin mourant, bras emporté, vers Aumetz (Moselle, 8 km plus au sud), où se trouve le P.C. de la division. Il revient à l’infirmerie d’Audun, où l’ambiance est tendue. Lui-même s’interroge sur la façon dont il va réagir aux événements, et avoue : « J’ai peur d’avoir peur ». Il repart, avec deux brancardiers qui, non sans avoir brièvement hésité, se sont portés volontaires pour aller chercher des blessés en territoire luxembourgeois, dans la ville d’Esch (à 4 km d’Audun). Un peloton moto a été stoppé net dans une rue, engins renversés, avec deux blessés. Un peu plus loin, une blindée a sauté sur une mine : ce sont deux morts qu’il faut évacuer, sans doute victimes des civils luxembourgeois qui les ont poussés à prendre ce chemin piégé.
Soubiran admire les officiers qui circulent debout, comme si les balles ne crépitaient pas. Il se demande quelle figure il fait lui-même. Aussi est-il réconforté par le cri d’un motard : « Mince ! il est gonflé, le toubib ». Il s’avance, en effet, avec son brassard à croix rouge, non casqué et les bras écartés pour bien montrer aux tireurs ennemis que ses intentions ne sont pas belliqueuses. « Je n’ai plus peur […]. Comme si j’avais franchi les bornes du monde. Que c’était simple ! ». Les brancardiers chargent les deux cadavres dans la sanitaire et, un peu plus loin, un homme blessé à la cuisse, puis quelques-uns encore. Mais un autre ne peut être pris en charge, car il ne veut pas se séparer de son fusil-mitrailleur (c’est interdit par les conventions de Genève). Satisfaction de la mission accomplie, et même « une ivresse organique de tout le corps », en réaction à la peur ressentie. « Nous avons reçu l’initiation redoutée. »
« À Audun, l’atmosphère a changé ! La route du Luxembourg s’est chargée de civils. » Ce sont les habitants d’Esch, où « la bataille de rues continue, meurtrière », qui passent se réfugier en France. À l’infirmerie, tout-à-coup, un cri – « Sauve-qui-peut, les Allemands sont là ! » – jette la panique. Fausse alerte, mais il est prudent de remmener les blessés sur la ligne Maginot. Sur le bord de la route, dans la nuit, Soubiran tente de dormir, allongé dans la sanitaire, ruminant les événements de cette journée qui a changé le cours de sa vie et celle de tous ses compagnons.
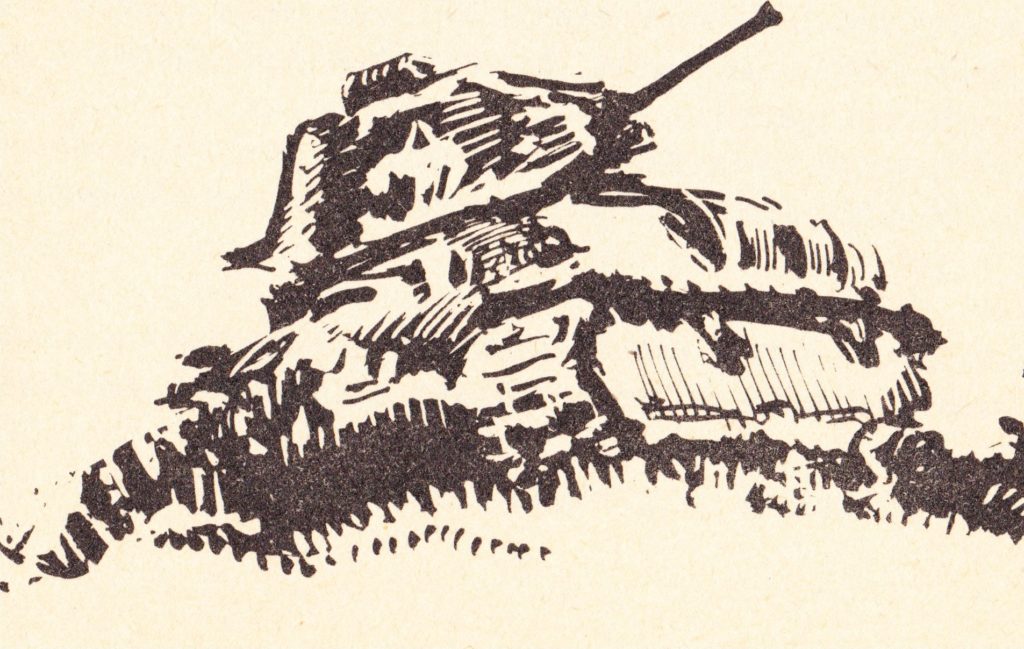
Dessin d’A. Brenet
Lendemains de bataille
Le 11 mai de bon matin, Soubiran retourne à Esch. La guérilla y continue. Des coups de feu partent des maisons. On n’est en sécurité nulle part. En fin d’après-midi, on reçoit l’ordre de repli sur Audun. Le lendemain 12 mai, le Génie fait sauter le viaduc : le réveil est brutal. À nouveau il faut se replier à l’abri de la ligne Maginot, à Murville (Meurthe-et-Moselle, 20 km au sud-ouest d’Audun). Mais l’atmosphère est joyeuse, après les premières épreuves surmontées, d’autant que les pertes sont relativement limitées.
Le 13 et le 14, les équipages des chars échangent leurs expériences du feu. Par exemple, ce sous-lieutenant chef de char, précédemment décrit comme « ahuri à lunettes, pâle et chaste jeune homme du type séminariste illuminé par la grâce »,qui, au cours du combat, « a vu mourir son adversaire, il l’a eu d’abord dans le rayon de son regard, il l’a eu vivant, faisant les gestes du combat, étrangement rapproché par les verres de sa lunette de visée. Il a tiré, il a vu la rafale entrer dans le corps […], le dernier regard […], les lèvres crispées sur un cri de stupeur et de révolte ». Comment ne pas être bouleversé, définitivement changé par ce dernier regard, à tout jamais ? Mais ce que le sous-lieutenant ne dit pas, et que rapportent ses camarades, c’est qu’ils l’« ont vu tranquillement sortir de son char, au milieu des balles, en pleine bataille, pour ramasser un cadavre ». Cet homme-là a pris dans l’événement une autre dimension, désormais « il peut tout commander. Il sera suivi partout ». Soubiran rend visite à une ambulance, où, sous une tente, gisent des cadavres allemands, et il ferme les yeux de deux d’entre eux. Plus tard, il accompagne une patrouille chargée de débusquer dans un bois des parachutistes fantômes, comme on a cru si souvent en voir dans ces premiers jours de bataille : la « parachutite » s’est partout répandue.
Le 15 mai, Soubiran voit passer une cavalcade de hussards à cheval devant les auto-mitrailleuses, étrange face-à-face de deux époques. Là-dessus, se produit un bombardement aérien massif. Le colonel commandant le régiment est amené, sérieusement blessé, de Landres (Meurthe-et-Moselle, à 3 km). Soubiran se rend dans ce village où un motocycliste a été « volatilisé » et où une tablée de soldats en train de prendre leur repas a été décimée.
Transfert vers la Champagne
Le régiment est appelé sur un autre théâtre d’opérations, il prend la route, traverse la Woëvre et, à Verdun (Meuse), emprunte la Voie Sacrée. Soudain, la colonne de fantassins qu’il longe saute dans le fossé, sous les tirs des avions en rase-motte ; les équipages des automitrailleuses en font autant, « un crépitement court sur nous, frappant la route, hachant les branches » ; et Soubiran reste pelotonné lui aussi sur le bas-côté, jusqu’à ce que le silence succède au tumulte. Il y a des blessés, des morts. Les brancardiers de l’unité d’infanterie « portent avec précaution, comme s’ils vivaient encore, des débris de corps ». Chose vue et gravée dans la mémoire : « ils jettent une toile de tente sur un corps sans tête ». Soubiran soigne les blessés. À Sainte-Menehould (Marne), beaucoup de maisons sont en ruines. Lors d’une alerte, il se réfugie dans une cave, bientôt ébranlée par une forte explosion. Puis, on reprend la route, de nuit à présent, au milieu de la cohue des civils qui fuient.
Au petit matin du 16 mai, ils sont arrivés au Pont-Faverger (Marne), à 20 km au nord de Reims. « Nous venons de faire d’une seule traite deux cents kilomètres, dont cent dans la nuit noire ». Très vite, ils repartent, s’arrêtent à Dizy-le-Gros (Aisne, à 55 km plus au nord). « Personne. Le silence. Le village n’est pas endormi […]. Il est vide » Quelques maisons présentent des traces de bombardements.
Dizy-le-Gros
Passent des troupes débandées. « Certains ont quitté leurs godillots. Ils les portent attachés autour du cou par des lacets. Ils marchent en savates, les ceinturons défaits, la vareuse déboutonnée, poussiéreux et suants […], la tête penchée, le regard morne ». Pour Soubiran et ses compagnons, c’est incompréhensible plus encore que scandaleux. Certains, des artilleurs, offrent encore un minimum de cohésion, sous la conduite d’un capitaine aussi débraillé que ses hommes, qui explique qu’à Sedan « son régiment a été pulvérisé par l’aviation, et que les Allemands ont passé la Meuse ». Il perçoit autour de lui un murmure de mépris. Il proteste que ses hommes et lui-même ont vraiment fait ce qu’ils ont pu. « Une par une, nos pièces ont été détruites. À la fin, il n’y avait plus de batterie, rien que ces quinze hommes et moi ». Il ne demande rien pour lui-même, mais il supplie qu’on fasse quelque chose pour sa troupe. Et, bien sûr, par compassion, on va le prendre en charge dans une sanitaire, avec les plus éprouvés de ses hommes. Un avion allemand survole le village. Une patrouille de chasseurs français l’attaque et l’abat, à la grande joie des Français. Mais une voiture criblée de balles arrive à toute vitesse : à l’intérieur, un commandant. Pour celui-ci, il n’y a plus rien à faire : il est mort.
Les communications radio avec la Division ne fonctionnent pas, et les agents de liaison motocyclistes envoyés chercher des instructions n’ont pas trouvé le contact. Soudain, les chars allemands attaquent le village de Dizy-le-Gros : « ils semblent de monstrueux rats gris. Ils avancent, le ventre dans la terre ». Tout ce que peuvent faire les sanitaires, c’est de se mettre à l’abri derrière une crête, tandis que se déchaîne la bataille. Puis les armes des automitrailleuses qui tenaient le village se taisent. Les défenseurs de Dizy-le-Gros ont succombé sous le nombre. Soubiran et les siens parviennent quand même à s’échapper avec leurs véhicules, et à gagner le camp de Sissonne (une quinzaine de kilomètres au sud-ouest), où tentent de se regrouper les débris de la 9ème armée.
Au voisinage de la division cuirassée du colonel De Gaulle
Au réveil, le 17 mai, le service sanitaire est appelé dans une clairière où une unité hippomobile a été anéantie : hommes et chevaux forment « un amas informe, une masse saignante et tragique ». Les rescapés de Dizy surviennent. Ils ont profité d’un bombardement de l’aviation française sur le village submergé par les blindés ennemis pour s’échapper. Avec eux un civil, le garagiste du village, « les yeux vides […] : son petit garçon a été tué dans la nuit près de lui ». Après avoir soigné les blessés, Soubiran profite du calme relatif pour rappeler le souvenir de tous ses camarades qui, la veille, ont perdu la vie, « au cours de cette journée brutale, héroïque ». Mais comment croire qu’on ne reverra plus des êtres « si chauds d’ardeur et de jeunesse » ? En pleine bataille, ce n’est pas encore le temps du deuil. Et il est permis de penser que leur sacrifice n’aura pas été vain. « La 4ème division cuirassée est arrivée cette nuit […], la division cuirassée, reine de la guerre moderne. ». Soubiran sait que la 4ème DCR est sous les ordres du colonel De Gaulle, mais il ne le mentionne que très discrètement (il publie son livre en zone sud en 1943) ; il sait également qu’à Montcornet à une vingtaine de kilomètres, ses trois cents chars vont incessamment livrer combat, – un des rares combats victorieux de ce mois de mai.
L’après-midi du 17, l’unité de Soubiran reçoit l’ordre de s’installer 2 km plus à l’ouest, au château de Marchais (Aisne). Du 3ème RAM ne restent plus que 5 automitrailleuses et une trentaine de motos. Dans la nuit, il faut repartir. Le 18, ils se trouvent dans un bois près de Laon (Aisne, à une vingtaine de kilomètres). Soubiran, parti acheter au village voisin des chaussettes pour son capitaine, est violemment pris à partie par la foule, qui le prend pour « un espion… un faux médecin… un parachutiste ». Le maire du village a toutes les peines du monde à le tirer de ce mauvais pas. Le 19, ils sont toujours au repos, dans la banlieue sud de Laon. Mais les avions allemands, trois par trois, les survolent en rase-motte, les bombardent, les mitraillent inlassablement, malgré la DCA. Un sous-officier, calmement, salue leurs passages d’une salve de son fusil-mitrailleur. D’autres en font autant. Ils ne sauront jamais lequel d’entre eux a finalement réussi à en toucher un.
Un officier de liaison propose à Soubiran de l’emmener à Laon. Là, ce dernier est en train, sur l’invitation du chef de char, à visiter un des gros chars B de la 4ème DCR : 32 tonnes, 2 canons, 4 hommes d’équipage. C’est un engin impressionnant, et dont il peut vérifier l’efficacité du blindage, car il est en train d’examiner l’intérieur lorsque des explosions le secouent et l’assourdissent, la fumée est telle qu’on ne voit rien par les fenêtres de visée. Retour au cantonnement, où un vieux sous-officier est devenu fou : il faut l’évacuer. Mais « on vient d’apprendre une grande nouvelle, une nouvelle qui, ce soir, l’emporte sur tout, donne à nouveau toutes les espérances. Le maréchal Pétain est appelé dans le gouvernement. Le général Weygand a pris le commandement ». À l’espoir qu’un sursaut militaire sous l’impulsion du vainqueur de Verdun va changer le cours des opérations, se mêle une fierté particulière : le fils du nouveau généralissime, le capitaine Jacques Weygand, commande un des escadrons du Régiment. Dans la nuit, des fusées s’élèvent tout autour de Laon quasiment encerclé. Mais que l’on se sent bien tout à coup ! « La nuit de mai est redevenue tendre, fraîche et vivante sous le ciel profond. »
L’horreur de la gare de Villers-Cotterets
À l’aube du lundi 20 mai, ce qui reste du Régiment repart, alors que la bataille autour de Laon reprend. Il passe à l’entrée du Chemin des Dames, terrible souvenir de la précédente guerre. À Soissons (Aisne), « les faubourgs, les raffineries de betteraves sont vides, portes béantes, verrières défoncées ». L’hôpital a déjà été évacué, mais une file de sanitaires attend à proximité : les conducteurs ne savent pas quoi faire de la quantité de blessés graves, voire mourants, qu’ils étaient chargés d’y conduire. Soubiran se met en colère, les somme de partir aussitôt vers Compiègne, sans attendre des ordres qui ne viennent pas, qui ne viendront pas.
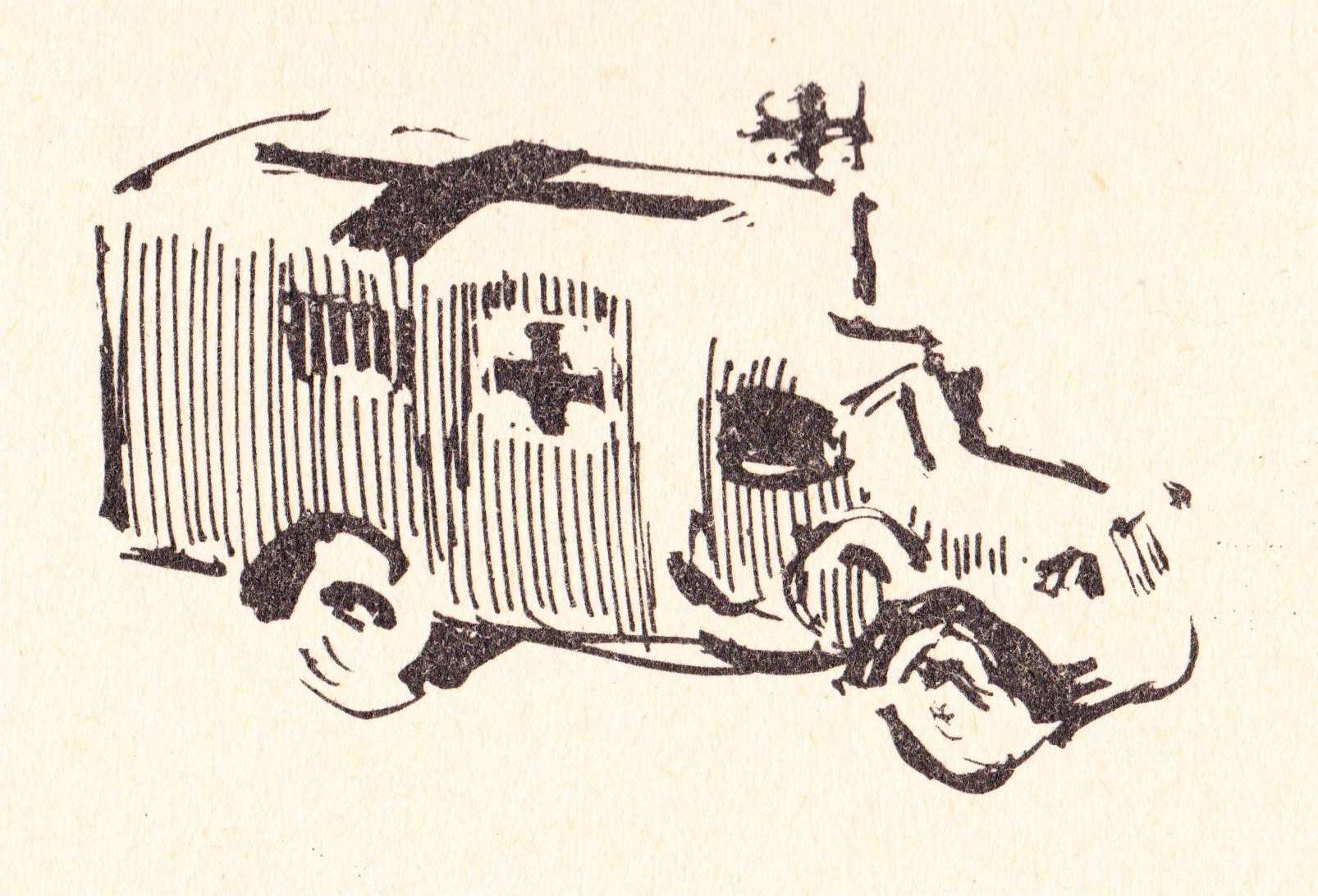
Dessin d’A. Brenet
Les véhicules de Soubiran pénètrent dans la forêt de Villers-Cotterets, « étrangement vaste, silencieuse et déserte ». « Depuis des jours, nous ne traversons plus qu’un monde mort. » Dans la ville (depuis Laon, une soixantaine de kilomètres), tout est désert aussi, y compris l’hôpital, sauf un infirmier qui est resté par conscience professionnelle, parce qu’il n’est pas concevable qu’un blessé qui se présenterait ne puisse recevoir au moins quelques premiers soins élémentaires. Soubiran est ému par cette leçon de modeste héroïsme. L’infirmier le guide jusqu’à la gare de Villers-Cotterets (Aisne), où un train du Génie a été attaqué par l’aviation allemande à l’aide de petites bombes anti-personnel au moment où il entrait en gare.
Le hall de la gare offre un spectacle de désolation. « Tout y est saccagé, effondré, soufflé. » Ce ne sont que corps affalés, vivants ou mourants. « Ils ont vu, ils ont reconnu mon képi, la croix rouge de mon brassard, et je suis pour eux […] la figure de l’espoir […]. Et je suis là, devant ces yeux implorants […]. Je ne puis les aider à vivre, ils sont trop, et je suis seul, les mains nues, mais je puis au moins les aider à mourir, être l’opium de ces âmes désespérées, donner l’opium à ces corps sanglants. J’ai encore ce pouvoir miséricordieux de changer les heures cruelles de l’agonie […] en un sommeil plein d’oubli, de jouer l’atroce comédie […] des mensonges consolateurs. » L’infirmier le prévient que deux sanitaires viennent d’arriver, qui ne peuvent prendre qu’une dizaine de blessés. Nouveau crève-cœur : choisir ceux qui garderont une chance d’être sauvés. « Choix qui m’apparaît brusquement inhumain, monstrueux. » Il parvient à en faire évacuer une douzaine. Même s’il sait qu’il a fait tout son devoir, le médecin qu’il est avant tout en restera durablement déchiré.
La marche vers la Somme
Le soir, une vingtaine de kilomètres plus au nord-ouest, près de Pierrefonds (Oise), dont ils aperçoivent le château, le groupe est hébergé dans une maison. Ils font « un bon dîner ». « Au début, les convives étaient mornes. Ils mangeaient en silence ». Le nom d’un de leurs camarades mort les jours précédent jette un froid glacial. Mais à la longue, « autour de cette table monta quelque chose de jeune, de fort, de radieux et de viril. Ils avaient rendu au malheur la minute de silence qui lui est due. Maintenant, ils se redressaient intacts, dominant leur tristesse et leur fatigue ». La conversation porte sur la contre-attaque qui certainement se prépare, qui sera certainement victorieuse.
Le 21 mai, ils reprennent la route, retournent à Soissons (30 km), encombrée par les réfugiés, d’où un ordre les redirige vers Château-Thierry (Aisne, 45 km au sud), et ils finissent par retrouver le reste du Régiment, dans un village où celui-ci devrait se reposer et se reformer. Mais non, le 22 mai, tandis que certains éléments sont appelés à faire mouvement vers le front de la Somme, le service sanitaire doit se rendre à Cramaille (Aisne, 25 km au nord), auprès de l’escadron de chars, dont les engins ont été retardés par des ennuis mécaniques et nécessitent entretien et réparations. Soubiran est heureux de se retrouver avec ses camarades perdus de vue depuis le Luxembourg, « dans une gentilhommière […] charmante et confortable ». Mais le 23, quand il est question de partir rejoindre sur la Somme le reste du Régiment, il apparaît clairement que les chars sont incapables de faire de longs trajets. Ceux-ci sont donc embarqués à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne) pour Saint-Denis, aux usines Hotchkiss ; et les équipages sont envoyés sur la Somme, où ils espèrent recevoir des chars neufs. Du 24 au 26, de Cramaille à un village picard anonyme, par Roissy-en-France, Beaumont, Beauvais, les camionnettes les transportent vers le secteur où le Régiment, déjà, depuis trois jours participe aux combats pour tenir la rive sud de la Somme (à 150 km, 180 peut-être, plus à l’ouest). Sur le chemin, Soubiran pratique un accouchement de fortune et tente à chaque étape de sauver la main d’un mécano qui a été coincée dans un engrenage.
À la recherche du matériel blindé
Mais sur la Somme, le 27 mai, les blindés ne sont pas au rendez-vous, il faut retourner à Paris les chercher, repasser par Beauvais et Méru bombardés. Pendant qu’on dit leur préparer leur matériel à Montlhéry (Essonne, 120 km au sud), ils peuvent se rendre quelques heures à Paris, où « tout nous paraît invraisemblablement normal, propre, paisible, intact ». Soubiran craignant, s’il revoit sa femme, un adieu déchirant, préfère demander l’hospitalité pour la nuit à un ami. Le 28, il fait admettre au Val-de-Grâce son mécano à la main blessée. Et puis, c’est la désillusion. « Ainsi, Montlhéry, c’était du bluff ! Des camions, des camionnettes, des sides, mais pas de chars ». Une démarche au Ministère de la Guerre leur permet au moins d’éviter la dissolution de l’escadron de chars.
Puis, « les jours ont glissé, sept jours ont fui entre mes doigts, comme de l’eau que je n’aurais pu retenir ». Finalement, Soubiran a pu apercevoir sa femme, gare d’Austerlitz, au moment où elle-même s’apprêtait à quitter Paris, il a vu « à une portière de wagon, la blondeur de ses cheveux, la lumière de son regard, la clarté de son visage, je suis resté comme ébloui ». Mais cette ville où la guerre ne s’est pas encore manifestée le trouble par sa tranquillité, son inconscience, son déni des événements : « même les nuits étaient splendides ». De Montlhéry, il continue à se rendre chaque jour à Paris. Un jour, dans un magasin où il voulait faire l’emplette de nouveaux vêtements, il retrouve brusquement dans une de ses poches, le carnet d’évacuation qu’il utilisait sur le théâtre d’opérations pour attacher une fiche à chacun des blessés évacués, et, tout d’un coup, « devant ce vendeur pommadé, joufflu et rose comme un bébé […], j’eus honte […] d’avoir pu oublier si vite la douleur des autres […], d’être devenu si vite semblable à ces passants qui, peu de jours avant, m’écœuraient de leur indifférence ». D’ailleurs, on finit par croire que l’offensive allemande est bel et bien stoppée sur la Somme. Mais « Tout a changé brutalement » le 7 juin.
La bataille de la Seine : Vernon
Quelques chars sont à nouveau disponibles. Le 8 juin, des porte-chars les acheminent jusqu’à Vernon (Eure, 100 km au nord-ouest), sur la rive sud de la Seine. Les équipages et les services les accompagnent en camionnettes. Là, Soubiran et ses compagnons voient passer la foule de l’exode, les vélos, les véhicules de toute sorte, les carrioles attelées, les piétons même ; et les stukas piquent sur cette masse avec le hurlement de leurs sirènes et la bombardent. La foule a beau se jeter dans le fossé, rien ne peut la protéger. D’un passage à niveau, « il ne reste plus rien. La terre est éventrée par un colossal entonnoir ». Wagons et autos flambent. Il y a des morts, quelques-uns démembrés. Le médecin à nouveau soigne les blessés, entre les alertes. Le capitaine chef du détachement décide de bivouaquer, comme c’était prévu, à proximité, dans le bois de Bizy. Mais « il est mauvais […] de rester […] au croisement de deux voies ferrées, près d’une gare, d’un passage à niveau, d’une caserne et d’un parc d’artillerie à la fois ».
Ils ne s’en apercevront que trop au petit matin du 9 juin, « lorsque des ronflements de moteurs, des éclatements de bombes » les réveillent. La foule, sur la route, continue à s’écouler interminablement. Une camionnette s’arrête : un brave homme y a recueilli agonisante, puis morte bientôt une vieille femme, dont il transporte le cadavre maintenant en putréfaction. Pour ne pas « allonger la liste des disparus », Soubiran décide de ne pas l’enterrer sur place, il transporte le corps dans une sanitaire, jusqu’à la morgue de Pacy-sur-Eure (Eure, à 12 km), et y emmène par la même occasion trois femmes et trois enfants épuisés. En principe les Allemands sont encore sur la rive nord de la Seine. Mais, alors qu’au retour à Vernon, il est en train de récupérer des produits, alcool, teinture d’iode, pansements, dans une pharmacie abandonnée qui va brûler, une mitrailleuse allemande commence à prendre la rue en enfilade. Soubiran réussit à se tirer de là, en rasant les murs. Mais ces tirs dans les rues de la ville encore aux mains des Français sont une énigme inquiétante.
« La Somme est perdue depuis longtemps et nous l’ignorions. Nous arrivons vraiment pour la partie décisive. La bataille de la Seine va commencer. »
Le Génie a fait sauter les ponts. L’escadron des chars fait mouvement de quelques kilomètres vers le sud, pour prendre position sur une hauteur, tandis qu’une colonne de fantassins précédée d’un officier à cheval, descend vers le fleuve pour tenter d’empêcher l’ennemi de le traverser.
La bataille de la Seine : Louviers
Au matin du 10 juin, les chars reçoivent l’ordre d’aller défendre Louviers, 40 km plus en aval sur la rive sud du fleuve (donc au nord-ouest de Vernon). Dans une ferme abandonnée, on fait la cuisine, on se restaure. Soubiran arrache au mur le calendrier des postes où figure la carte sommaire du département. Faute de cartes Michelin, cela servira tout de même à s’orienter. Les trois escadrons partent en patrouilles de divers côtés. Dans l’après-midi, une fumée épaisse couvre le paysage : les réservoirs de Rouen brûlent. Alors apparaît la réalité de la situation : « Nous sommes seuls, perdus dans la nature. L’infanterie allemande est à deux kilomètres ». Dans la carrière proche, s’ouvrent des grottes, où Soubiran fait entrer la sanitaire et ses infirmiers. C’est là qu’ils vont essayer de dormir, malgré le grondement des tirs d’artillerie, le claquement des mitrailleuses, dans la crainte de se réveiller prisonniers.
À l’aube livide et brumeuse du 11 juin, un motocycliste vient leur transmettre l’ordre de rejoindre au bivouac, dans le bois de Bord près du confluent de l’Eure et de la Seine, le Régiment revenu de la Somme, éprouvé par de durs combats. Les hommes sont épuisés après « six jours et six nuits sans sommeil […]. Ce sont les mêmes que j’ai vus partir, il y a un mois, joyeux et bien équipés, avec de puissantes machines […]. Un mois seulement ! Combien déjà sont morts, et, ceux qui restent, comme ils sont vieillis ! ».
La division reconstituée doit tenir un front étendu, d’Elbeuf à Vernon, en suivant le cours sinueux de la Seine (plus de 60 km), que déjà depuis la ville, les avant-gardes allemandes ont franchi en canots pneumatiques. Un camarade sous-lieutenant descend méconnaissable de son automitrailleuse. « Depuis huit jours, il se bat sans manger […], avec une angine qui gonfle douloureusement sa gorge de pus ». Il n’a pas voulu quitter son poste de combat pour se soigner. La veille, il a failli être tué, la tête hors de sa tourelle. Le matin même, une balle a traversé son casque. Il a de la fièvre. Bon gré, mal gré, il lui faut maintenant accepter d’être évacué, d’ordre du médecin Soubiran. En fin de journée, il faut se replier ; la relève est assurée par des fantassins.
Le 12 juin, l’escadron est allé s’installer à Vraiville (Eure, à 10 km à l’ouest de Louviers) déserté par ses habitants. Une blindée envoyée en reconnaissance à Évreux, déjà aux mains de l’ennemi, s’est attaquée à un groupe de motocyclistes allemands et a eu l’audace de ramener une moto comme prise de guerre ! L’équipage d’une autre automitrailleuse, dans la boucle des Andelys, a été exterminé. Deux pelotons ont disparu.
Le repli vers l’Orne du régiment fantôme
Le Régiment « n’est plus qu’une illusion de demi-brigade : des débris de pelotons, des fantômes d’escadrons » qui doivent aller au repos. En fait, ils errent pendant quatre jours. D’abord, ils roulent vers le sud, passent au Neubourg (Eure) où « une foule de réfugiés écrasés de lassitude et de tristesse, stagnait sur la grande place […]. Nous recevions au passage des appels poignants de détresse ». Au sortir de la forêt de Beaumont-le-Roger (Eure), la colonne subit une sérieuse attaque aérienne. Ils traversent le pays d’Ouche, dépassent la Ferté Fresnel (Orne), et la forêt de Saint-Evroult. Repos bienvenu à Ferrières-la-Verrerie (Orne, après 140 km de route depuis Vraiville), pour la révision des véhicules : « même dans ce petit village loin des grandes route, nous avons trouvé l’habituelle foule des réfugiés ». C’est là qu’ils apprennent la prise de Paris (on est donc le 14 ou le 15 juin). À Larré (Orne), Soubiran est appelé auprès d’un réfugié, qu’il juge aussitôt mourant : « J’ai trouvé que dans l’amertume de l’exode cette mort ne manquait pas de noblesse pour ce vieux paysan allongé au pied d’un arbre contre la terre » à laquelle il allait retourner comme pour s’y enraciner. Ils arrivent à Sées (Orne) : il devait s’agir de tenir sur l’Orne, de là jusqu’à Argentan, un front de 23 km. Mais très vite l’ordre vient de décrocher sur la Ferté-Macé (Orne, 140 km depuis Ferrières).
Et le 17 juin, lors d’un arrêt dans un petit village, un messager vient apporter au commandant le texte du discours radiodiffusé de Pétain : « le commandant lisait en silence, nous le vîmes pâlir sous l’émotion […], [il] voulut parler, mais, la gorge contractée, sans force, sans voix […], il s’assit brusquement ». Les officiers les plus âgés partagent la même hébétude ; les jeunes, les lieutenants, les sous-lieutenants se révoltent, ce qu’ils veulent, c’est finir en beauté. Tout-à-coup, d’ailleurs, un motocycliste apporte un ordre de combat : « La demande d’armistice n’arrêtait pas la guerre […]. Il fallait continuer de mourir ».
Derniers exploits
Un peloton tiendra jusqu’au soir la position-clé de la Ferté-Macé. Blindés et dragons portés prennent position à Carrouges et s’attaquent victorieusement à un détachement ennemi. Un peloton de trois chars prend à revers une file de camions ennemis, et, en la remontant par la gauche et par la droite en tirant jusqu’à épuisement de ses munitions, anéantit cette colonne. « Cet après-midi du 17 juin, une fureur sacrée anima le régiment. » Et finalement, les Allemands ont subi un tel choc que, le soir, les troupes françaises peuvent décrocher sans difficulté malgré l’inégalité des effectifs et des moyens. Les voici dans la forêt d’Andaine (entre Bagnoles-de-l’Orne et Domfront, Orne), sur les chemins forestiers, plus sûrs que les routes. À la hauteur de Ceaucé (Orne), il leur faut couper « un monstrueux fleuve de débâcle qui déferle droit vers le sud », charriant les débris d’une unité d’artillerie hippomobile, fourragères, chevaux, caissons.
L’ordre était de gagner Saint-Fraimbault (Orne, 40 km depuis la Ferté-Macé) : ce qui reste du Régiment, sous les ordres du commandant L’Hotte, qui, depuis la Somme, remplace le colonel, y parvient vers minuit. De toute façon, impossible d’aller plus loin, la carburant a été épuisé par les combats et le trajet effectués au cours de cette journée. « Chacun, à cette minute, a compris : demain matin nous serons prisonniers. Prisonniers, mais pas sans combattre, car le commandant fait organiser défensivement ce village ». Le maire et les habitants participent à ce dernier effort en assurant leur ravitaillement. Le commandant, ayant perdu tout contact avec la brigade et avec la division, trouve dans sa foi et dans son sens de l’honneur militaire la force qui continue d’entraîner ses hommes. Soubiran ne parvient guère à dormir. Il est entièrement occupé par les souvenirs, par la pensée de sa famille, de son fils de sept ans. Cependant, « je n’ai jamais eu de ces pressentiments que l’on attribue à ceux qui vont mourir. Je m’aperçois même que je n’ai vraiment cru à aucun moment, depuis le 10 mai, que je pourrais mourir dans cette guerre ».
Prise du village, évasion « au culot », passage de la Loire
Au petit matin du 18 juin 1940, les canons grondent, les armes automatiques claquent. Puis, tout-à-coup, silence ! Sur la place au centre de Saint-Fraimbault, mêlés aux civils et aux troupes françaises, une vingtaine de motocyclistes allemands sont là, et bientôt davantage, et de plus en plus. Impossible de tirer dans ces conditions. « Je regarde mes camarades. La stupeur est encore sur leurs visages noués de grimaces nerveuses et qui ont blêmi de rage. Nous sommes prisonniers sans même avoir eu le temps de nous en rendre compte, sans même avoir bien compris comment. » En fait, les barricades dressées aux entrées du village ont été d’abord submergées par des troupes en débâcle, ainsi que par les civils de l’exode, et les avant-gardes allemandes ont surgi tout-à-coup, « nos postes surpris et vite cernés n’avaient pu tirer, c’eût été le massacre indistinct ». Un officier allemand vient chercher le commandant pour qu’il règle avec le général allemand les conditions de cette espèce de reddition : les hommes seront désarmés, mais les officiers, « en hommage à leur belle conduite » pourront garder les leurs.
Soubiran a chargé un blessé de la veille dans une sanitaire et, payant d’audace, se mêle à la colonne des véhicules allemands qui filent vers la Manche. Puis, au premier moment favorable, il quitte la route, tourne à gauche, vers la Loire. Visiblement, les Allemands ne réagissent pas. Mais un peu plus tard, la sanitaire se retrouve à nouveau, sur une grande route, prise au milieu d’une colonne allemande. À Saint-Denis de Gastines (Mayenne), des habitants leur fournissent des cartes Michelin, et le conseil d’éviter Ernée. « Avec la carte, tout devint facile. ». Au Bourgneuf-la-Forêt (Mayenne), occupé par les Allemands, il faut quelque peu forcer le passage. Mais leurs précédents succès leur ont insufflé un surcroît d’audace. Et enfin, à Pouancé (Maine-et-Loire), ils se retrouvent au milieu d’une troupe française en retraite, des cavaliers montés harassés et leurs chevaux fourbus. « Ils gardaient […] une cohésion que maintenait encore une fière volonté de discipline. » Cependant, la sanitaire allait manquer de carburant lorsque, par un coup de chance incroyable, à l’entrée de Juigné-des-Moutiers (Loire Atlantique), ils rencontrent un officier de leur régiment chargé justement des approvisionnements, qui est là avec quelques véhicules et… un camion-citerne.
Les voici en vue de la Loire. « Mon cœur se dilatait. Je cessais de sentir sur ma poitrine le poids qui l’avait oppressée. » Mais le blessé se plaint, l’appelle, il souffre. « Parce que j’avais vu la Loire, pour moi tout était loin déjà […]. Déjà, il me fallait le gémissement d’un blessé […] pour me rappeler l’amas des souffrances qui étaient passées devant mes yeux, entre mes mains. » Il l’hospitalise à Nantes, dans le lycée transformé en hôpital complémentaire. Ensuite, au soir de ce 18 juin 1940, qui – Soubiran et ses compagnons ne le savent évidemment pas –, restera dans l’Histoire, au soir d’une journée qui, extraordinaire aussi pour eux, s’est comme dilatée et remplie de dangers et de chances (sur 180 km de routes hasardeuses), il ne leur reste plus qu’à passer la Loire sur des ponts encombrés (il leur faut trois heures), puis ils filent vers le Sud, vers la Liberté ; Soubiran pour sa part vraisemblablement vers sa petite patrie de Gimont (Gers), où il mettra au net son journal de guerre.
André SOUBIRAN (1910-1999), J’étais médecin avec les chars, journal de guerre (Didier Toulouse, 1943), réimpression SEGEP, Paris, 1950, 320 p. – Illustrations d’ A. Brenet. – « Récit de quarante journées et de quarante nuits », du 9 mai au 18 juin 1940. Tout au long de la campagne, il a tenu son journal sur « un carnet de route épais et solidement relié ». Aussi peut-il se porter garant de l’exactitude de son rapport : « Les faits, les lieux, les dates de ce récit sont authentiques ». Cela allait sans dire, mais il faut se souvenir qu’ont été publiés tant de récits sur juin 40 qui font une part plus ou moins belle à l’invention, que cela va peut-être mieux encore en le disant. Ce livre fut, à juste titre, un grand succès de librairie des années de l’Occupation. J’étais médecin avec les chars fut distingué par le prix Renaudot en 1943. Soubiran se fit également connaître plus tard comme auteur des quatre tomes des Hommes en blanc (1947-1958).
Passer de l’angoisse juste avant le contact avec le feu à une sorte d’euphorie qui autorise certains à se transformer en figure de proue défiant les projectiles, puis en bouillie mêlant chevaux terre et victimes, est un des pièges troublants du combat: la drogue que diffusent ces situations et fait qu’on les recherche. Un pacifiste de 1914 confessait déjà avoir été transformé dès 1917 en être violent avide de sensations. le texte de Némirovsky est troublant lui aussi…